DTU 13.3 : Règles des Fondations et Dallages sur Terre-Plein

Sommaire
Le DTU 13.3, c’est un peu comme la bible des professionnels pour les dallages en béton sur terre-plein. Plus qu’un simple guide technique, cette norme française est le fruit de décennies d’expérience et d’expertise. Prêt à connaître tous les secrets d’un dallage bien conçu ? Entrepôt industriel, bâtiment collectif, maison individuelle : le DTU 13.3 vous accompagne de la conception au calcul en passant par la mise en œuvre. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la norme DTU 13.3 !
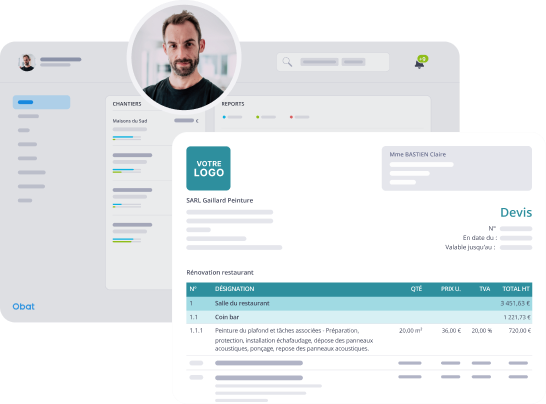
DTU 13.3 : définition et règles
Le DTU 13.3 (Document Technique Unifié 13.3) est une norme française qui régit la conception des dallages sur terre-plein.
Qu’est-ce que le DTU 13.3 ?
Les Documents Techniques Unifiés sont des référentiels qui définissent les règles d’exécution des ouvrages. Fondés sur les pratiques éprouvées, ils sont devenus des normes officielles françaises (NF) depuis 1990. Le DTU 13.3 (norme NF P 11-213, révisée en décembre 2021) encadre ainsi la conception, le calcul et l’exécution des dallages en béton.
Il se divise en plusieurs parties principales :
- Partie 1-1-1 : les dallages pour tous types d’ouvrages, sauf les maisons individuelles.
- Partie 1-1-2 : les dallages des maisons individuelles, avec des règles adaptées aux faibles contraintes résidentielles.
- Partie 1-2 : les critères généraux de choix des matériaux (CGM) pour toutes les clauses techniques.
- Partie 2 : les clauses administratives spéciales (CCS) pour encadrer les contrats et marchés de travaux.
Pourquoi respecter les normes DTU ?
Artisans et professionnels du BTP, vous avez tout intérêt à respecter les normes de construction DTU 13.3 pour plusieurs raisons :
- Qualité des travaux : les DTU définissent des méthodes reconnues pour obtenir des dallages fiables et durables. Vous évitez les erreurs de conception ou de mise en œuvre qui pourraient ensuite causer des fissures ou des affaissements (des problèmes qui coûtent souvent cher à réparer !).
- Sécurité des ouvrages : la norme prend en compte les contraintes spécifiques (charges, trafics, conditions climatiques) pour assurer la sécurité des utilisateurs et la stabilité de la structure.
- Conformité aux obligations légales : le DTU 13.3 protège les constructeurs et les maîtres d’ouvrage sur le plan juridique. Il faut d’ailleurs savoir que les garanties décennales ou autres assurances obligatoires en BTP imposent souvent le respect de ces normes DTU.
Où s’applique le DTU 13.3 ?
Le DTU 13.3 concerne trois types de constructions :
- Dallages à usage industriel ou assimilé : usines, ateliers, entrepôts, laboratoires, grandes surfaces commerciales (> 1000 m²), chambres froides, etc.
- Dallages à usage autre qu’industriel : constructions collectives, bureaux, établissements scolaires, sportifs, agricoles, garages, etc.
- Dallages de maisons individuelles : dallages exclusivement en béton armé.
Règles de conception et de mise en œuvre
De la composition du béton à la gestion des joints, chaque détail compte et le DTU 13.3 impose des règles claires de mise en œuvre.
Exigences pour le béton utilisé
Un dallage solide et durable commence par un béton parfaitement adapté. Le DTU 13.3 fixe ainsi des règles précises à ce sujet :
- Dosage en ciment : le béton doit contenir entre 280 et 400 kg de ciment par m³, en fonction des contraintes du dallage.
- Classe de résistance : la résistance minimale exigée est de C25/30 pour les dallages industriels et non-industriels, et de C20/25 pour les dallages de maisons individuelles. Une classe supérieure peut être nécessaire pour des conditions spécifiques (trafic intense ou agressions chimiques).
- Rapport eau/liant : le mélange doit respecter un ratio eau/liant situé entre 0,5 et 0,6. Cette consistance est optimale pour éviter les fissurations.
Dimensions et armatures des dallages
Les dimensions et les armatures jouent un rôle fondamental dans la performance structurelle des dallages :
- Épaisseur minimale : 150 mm pour les dallages industriels, 130 mm pour les dallages non-industriels, 120 mm pour les maisons individuelles.
- Armatures :
- Pour les dallages en béton armé, les armatures doivent représenter 0,2 % de la section de béton dans chaque sens (dallages résidentiels).
- Pour les usages industriels, les diamètres et espacements des armatures sont déterminés selon la contrainte : diamètre ≤ 1/15ᵉ de l’épaisseur et espacement ≤ 2 fois l’épaisseur.
Gestion des joints (dilatation, retrait, isolement)
Des joints bien placés sont indispensables pour préserver la durabilité du dallage face aux contraintes :
- Joints de dilatation : ils viennent compenser les variations dimensionnelles dues aux changements de température. Leur emplacement et leur espacement sont définis selon la surface du dallage et son exposition thermique.
- Joints de retrait : ils sont prévus pour limiter les fissures dues au retrait du béton lors du séchage. Ces joints sont tracés avant les travaux pour guider les éventuelles fissures vers des zones maîtrisées.
- Joints d’isolement : ils séparent le dallage des autres structures (murs, poteaux, fondations) pour éviter le transfert de contraintes.
Points spécifiques pour chaque type de dallage
Chaque type de dallage a ses propres exigences, adaptées aux contraintes et aux usages. Ainsi, le DTU 13.3 impose des solutions différentes pour chaque situation.
Dallages industriels : contraintes et solutions
Les dallages à usage industriel ou assimilé doivent répondre à des exigences très strictes, dans la mesure où ils subissent des charges d’exploitation importantes (charges lourdes, trafics intenses, agressions chimiques, thermiques ou physiques) :
- Épaisseur minimale : ≥ 150 mm pour garantir la résistance mécanique.
- Armatures :
- Diamètre ≤ 1/15ᵉ de l’épaisseur.
- Espacement ≤ 2 fois l’épaisseur.
- Spécifications fournies par l’ingénieur béton.
- Béton :
- Résistance minimale : C25/30.
- Dosage en ciment : 280 à 350 kg/m³.
- Rapport eau/liant : entre 0,5 et 0,6.
- Support : réalisé avec une forme d’assise et une couche de réglage pour assurer la stabilité.
- Protection et durabilité :
- Calepinage obligatoire pour les joints (construction, retrait, dilatation).
- Écran antipollution pour éviter les migrations de produits et l’humidité.
- Cure nécessaire pour éviter l’évaporation prématurée de l’eau du béton.
- Couches d’usure : réalisées par saupoudrage ou coulis sur béton frais pour les usages intensifs.
Dallages non-industriels : exigences allégées
Pour les dallages non-industriels, ils supportent des charges modérées et un trafic moins intense. Cela permet de réduire les exigences par rapport aux usages industriels :
- Épaisseur minimale : ≥ 130 mm, ajustée à des sollicitations moindres.
- Armatures :
- Pour les dallages en béton armé, section minimale de 5 cm²/m par sens.
- Réduction possible à 3 cm²/m sous conditions (définies par le DTU).
- Béton :
- Résistance minimale : C25/30.
- Dosage en ciment : 280 à 350 kg/m³.
- Rapport eau/liant : entre 0,5 et 0,6.
- Support et interface : similaires aux dallages industriels, avec forme d’assise, couche de réglage, et éventuellement un film antipollution ou pare-vapeur.
- Durabilité :
- Calepinage des joints (construction, retrait, dilatation).
- Cure pour limiter l’évaporation de l’eau du béton.
- Possibilité de couches d’usure pour prolonger la durée de vie.
Dallages pour maisons individuelles : particularités
Concernant les maisons individuelles, le DTU 13.3 se concentre sur la compatibilité avec le sol. Il vise aussi à prévenir les problèmes structurels :
- Épaisseur minimale : ≥ 120 mm.
- Armatures :
- Représentent 0,2 % de la section du béton dans chaque sens.
- Dimensionnement conforme aux règlements du béton armé.
- Béton :
- Résistance minimale : C20/25.
- Dosage recommandé : 400 kg/m³ (béton à composition prescrite).
- Béton vibré ou fluidifié avec plastifiant (sans ajout d’eau).
- Support et assise :
- Forme d’assise de 20 cm minimum.
- Couche de glissement protégée par un lit de sable (5 cm) ou mortier maigre (3 cm).
- Film anticapillaire et/ou pare-vapeur recommandé pour éviter l’humidité.
- Reconnaissance géotechnique :
- Obligatoire pour les maisons jumelées ou en bande.
- En l’absence d’étude, l’entrepreneur doit réaliser une enquête préalable (nature du sol, risques, etc.).
- Durabilité : cure pour éviter l’évaporation de l’eau contenue dans le béton.
Étapes de préparation et de vérification
Pour un dallage conforme aux règles du DTU 13.3, une préparation soignée et des vérifications rigoureuses sont essentielles.
Études géotechniques préalables
L‘étude géotechnique est une étude de faisabilité, indispensable pour préparer un dallage solide et durable. Elle évalue les caractéristiques du sol, comme sa portance ou son homogénéité. Avant de commencer leur chantier, les professionnels doivent ainsi vérifier :
- la présence d’anciennes carrières ou remblais ;
- les risques de glissement ou d’inondation ;
- la proximité de la nappe phréatique.
Ces informations précieuses permettent ensuite d’adapter la conception du dallage. Que faire en cas d’absence d’étude géotechnique ? Dans ce cas, l’entrepreneur mène des enquêtes terrain pour collecter les données nécessaires.
Importance du calepinage et de la cure
Un bon calepinage signifie que les joints sont bien positionnés pour absorber les mouvements et éviter les fissures. Chaque type de joint (dilatation, retrait, isolement) doit alors répondre aux spécificités du projet.
Quant à la cure, elle protège le béton en empêchant une évaporation trop rapide de l’eau. Sans cette étape, le béton risque de se fissurer ou de perdre en résistance ! On utilise alors des techniques adaptées comme l’arrosage, le bâchage ou l’application de produits de cure.
Les erreurs courantes à éviter
Les normes de conception des dallages DTU 13.3 ne doivent pas être perçues comme des contraintes, mais plutôt comme un soutien pour pallier les erreurs les plus fréquentes :
- Non-respect des épaisseurs minimales : un dallage trop fin peut ne pas supporter les charges prévues, avec un risque de fissures ou d’affaissements prématurés.
- Absence de reconnaissance géotechnique : ignorer l’état du sol peut entraîner des désordres graves, comme des affaissements ou des remontées d’humidité. D’où l’important de l’étude géotechnique !
- Défauts de gestion des joints : des joints mal placés ou insuffisants favorisent les fissures, problème qui peut être évité avec un calepinage précis.
Le DTU 13.3 est une référence essentielle pour garantir la qualité et la durabilité des dallages sur terre-plein. Respecter ces normes permet d’assurer la sécurité, l’efficacité et la conformité des chantiers. Vous souhaitez une gestion optimale de vos chantiers ? Découvrez les outils de planification et de gestion proposés par Obat pour simplifier vos travaux.
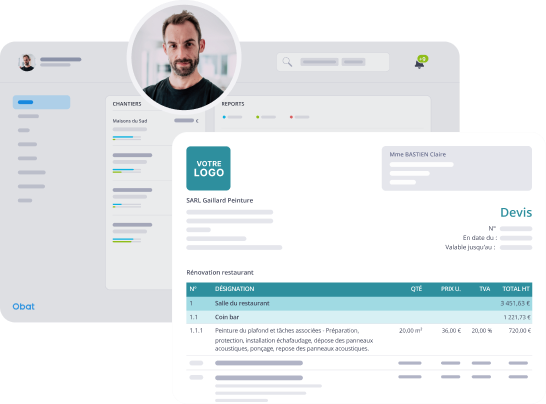
Plus de conseils pour vos travaux

Pourquoi et comment digitaliser ses contrats de gaz et d’électricité ?
Aujourd’hui, les nouvelles technologies offrent la possibilité aux nombreux ménages français de faciliter leurs démarches administratives : souscription, recherche d’informations,...

Kbis artisan : coût et démarches d’obtention
L'obtention d'un extrait Kbis permet de confirmer la légalité d'une entreprise. Toutefois, la nécessité de ce document varie selon le...

30 décorateurs d’intérieur à suivre sur Instagram en 2025
Grâce à Instagram, de nombreux artistes ont pu faire découvrir leur travail à une large audience. Et les décorateurs d’intérieurs...
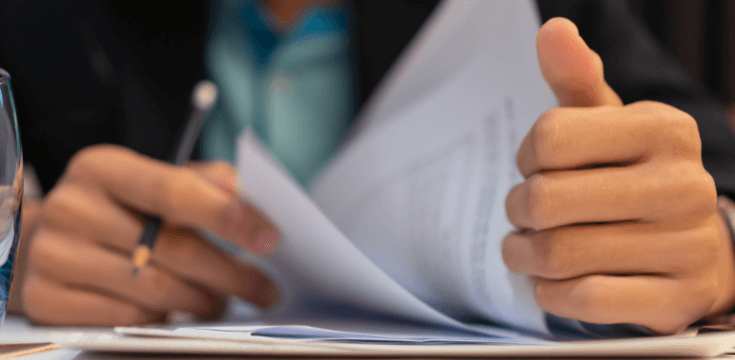
Qu’est ce qu’un Kbis ? Définition et comment l’obtenir
L'extrait Kbis d’une entreprise peut être assimilé à sa carte d’identité : c’est un document officiel qui prouve la création...

8 services juridiques pour créer une SASU en ligne|Comparatif
Comment ouvrir une SASU ? Au moment d’amorcer les démarches de création, il est possible que vous vous sentiez un...

Comment fonctionne l’épargne salariale avec Pro BTP et quels avantages ?
Explorons ensemble un sujet crucial pour les employés et les entreprises du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP)...
